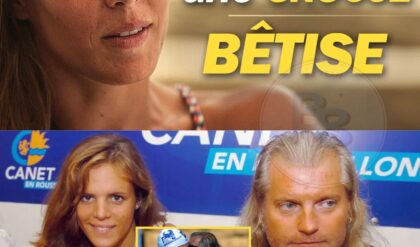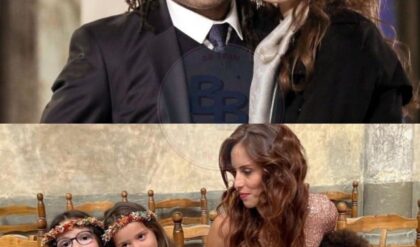Amir face au boycott : « Je ne connais qu’une seule réponse à la haine… »
La 31e édition des Francofolies de Spa, qui s’est déroulée du 17 au 20 juillet dans le cadre bucolique des Ardennes belges, devait être, comme chaque année, une grande fête de la musique francophone. Le public y a retrouvé des têtes d’affiche comme IAM, Dadju, Kendji Girac, Julien Doré ou encore l’iconique Véronique Sanson. Pourtant, au cœur de cette célébration artistique, un conflit politique a surgi, éclipsant partiellement l’aspect festif de l’événement. Au centre de la polémique : le chanteur franco-israélien Amir, visé par un appel au boycott lancé par le collectif militant « Liège Occupation Free ».
Un appel au boycott retentissant
C’est le 26 juin dernier que le collectif « Liège Occupation Free » a pris la parole sur Instagram pour accuser Amir d’un certain nombre de faits considérés comme incompatibles, selon eux, avec l’esprit de solidarité humaniste du Festival. Le collectif reproche à l’artiste d’avoir servi comme sergent-chef dans les services de renseignements de Tsahal (l’armée israélienne), d’avoir participé à une soirée organisée par Yoni Chetbon, un militaire israélien affilié selon eux à un parti qualifié « d’extrême droite », et enfin, de garder le silence sur les violences en cours dans la bande de Gaza.
Ces accusations ont rapidement déclenché une onde de choc. À peine le communiqué publié, plusieurs artistes programmés aux Francofolies ont exprimé leur malaise, voire leur opposition à partager la scène avec Amir. Le climat est devenu lourd, et la tension palpable, sur fond de conflit géopolitique exporté dans l’espace culturel européen.
Des artistes prennent position
Dans la foulée de l’appel au boycott, un autre communiqué a été publié. Celui-ci émanait d’un groupe d’artistes belges engagés dans la scène musicale alternative : Colt, Lovelace, Nicou, Lauravioli, Isaac, ou encore Li. Tous ont exprimé leur soutien au mouvement de boycott et leur refus implicite d’être associés, de près ou de loin, à ce qu’ils considèrent comme une forme de « normalisation » d’une situation qu’ils jugent injuste au Moyen-Orient.
Ces artistes ne s’en sont pas tenus à de simples mots : certains ont même envisagé de se retirer du festival si la direction ne reconsidérait pas la présence d’Amir dans la programmation. Pour eux, la musique ne peut être détachée des enjeux politiques et humains. Le Festival, quant à lui, s’est retrouvé pris dans une tourmente difficile à gérer : fallait-il céder à la pression militante, ou maintenir coûte que coûte une ligne artistique indépendante des enjeux politiques internationaux ?
Amir brise le silence
Face à cette montée en tension, le principal intéressé, Amir, est longtemps resté silencieux. Mais alors que la pression devenait de plus en plus forte, il a finalement réagi avec sobriété et émotion. Sur ses réseaux sociaux, l’artiste a publié une déclaration sobre mais puissante :
« Je ne connais qu’une seule réponse à la haine : l’amour. »
Avec cette simple phrase, Amir a souhaité prendre de la hauteur, refusant de répondre à la polémique sur le même ton que celui de ses détracteurs. Son choix de ne pas rentrer dans un débat politique, mais de rappeler son message artistique et universel, a été salué par une partie de ses fans.
Amir, révélé au grand public par The Voice en France, est aujourd’hui connu pour ses titres fédérateurs et positifs comme J’ai cherché, On dirait ou Longtemps. Sa musique, empreinte d’émotion et de bienveillance, contraste fortement avec les accusations dont il fait l’objet. Pour beaucoup, sa présence sur scène ne devrait pas être politisée, surtout en l’absence de prise de position publique explicite sur le conflit israélo-palestinien.
Un festival tiraillé
La direction des Francofolies, de son côté, a maintenu la présence d’Amir dans sa programmation, tout en rappelant son attachement à la diversité des voix artistiques et à la liberté d’expression. Ce choix n’a pas fait l’unanimité. D’un côté, les partisans du boycott dénoncent une forme de complicité implicite avec l’oppression en ne prenant pas parti. De l’autre, des voix s’élèvent pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une dérive dangereuse : celle d’un tribunal populaire qui s’arroge le droit de juger les artistes en fonction de leur passé ou de leurs origines.
L’incident soulève une question plus large, déjà présente dans d’autres événements culturels en Europe : peut-on dissocier l’art de l’artiste ? Est-ce qu’un festival de musique est le lieu approprié pour exprimer des revendications politiques internationales ? Et jusqu’où doit aller la responsabilité des organisateurs face aux engagements passés – ou supposés – des artistes qu’ils invitent ?
Une polarisation croissante
L’affaire Amir aux Francofolies de Spa illustre la polarisation croissante de la société face aux conflits géopolitiques. Elle rappelle aussi combien les artistes, qu’ils le veuillent ou non, sont désormais au centre d’enjeux politiques dépassant souvent leur intention première. Pour certains, refuser de prendre position est déjà un choix politique ; pour d’autres, la neutralité est un droit fondamental, surtout dans le cadre artistique.
La réaction d’Amir, tout en retenue, a eu le mérite d’apaiser les tensions sur les réseaux sociaux, sans pour autant éteindre complètement la controverse. Il a chanté sur scène comme prévu, salué par une majorité du public, mais aussi surveillé de près par les militants présents aux abords du festival.
Une affaire qui fera date ?
Ce moment restera sans doute comme l’un des épisodes les plus tendus de l’histoire récente des Francofolies de Spa. Au-delà du cas Amir, il pose la question plus large du rôle de la culture en période de guerre et de conflit idéologique. La musique, longtemps perçue comme un vecteur de paix et de rassemblement, est-elle en train de devenir un nouveau champ de bataille politique ? Ou peut-elle encore, malgré tout, servir de pont entre les peuples, au-delà des divisions ?
Dans ce climat parfois électrique, la réponse d’Amir – simple, presque naïve – prend un relief particulier. Et si, au final, l’amour, l’art et la musique restaient les dernières armes efficaces contre la haine ? Une chose est sûre : le débat est loin d’être clos.